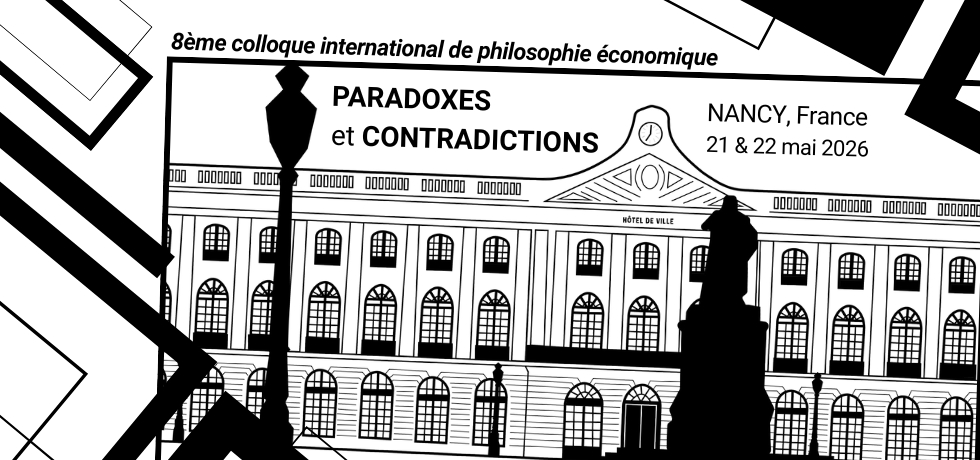
|
PRESENTATION Le 8e colloque international de philosophie économique se tiendra à l’Université de Lorraine, à Nancy, les 21 et 22 mai 2026. Cette 8e édition portera sur le thème des paradoxes et contradictions. Les propositions de communications sur tout sujet à l'intersection de l'économie et de la philosophie sont les bienvenues.
KEYNOTE SPEAKERS Nous aurons l'honneur de recevoir deux conférencières invitées :
Prof. Nancy Cartwright Prof. Elizabeth Maggie PennDurham University and Emory UniversityUniversity of California San Diego
CALL FOR PAPERS Paradoxes et contradictions De toutes les sciences sociales et humanités, la philosophie et l’économie sont sûrement les plus friandes de paradoxes et de contradictions. Loin d’être de simples curiosités ou des jeux de l’esprit, ils stimulent les développements théoriques, ils alimentent la réflexion critique, ils mènent à des percées épistémologiques ou peuvent, plus humblement mais tout aussi efficacement, jouer un rôle rhétorique. Présents dans le raisonnement mathématique, le raisonnement analytique, la modélisation, l’établissement de faits stylisés, la théorie de la décision ou l’analyse des politiques publiques, ils nous obligent à affronter la cohérence et les limites du savoir. Le colloque permettra, pour la série de communications qui rentrera dans le thème, de documenter l’ampleur de ces paradoxes et d’en caractériser plus finement la nature et les usages. Certains paradoxes classiques intriguent les philosophes depuis des siècles, tels que le paradoxe du menteur, le paradoxe sorite ou les paradoxes de Zénon. D’autres sont plus récents et illustrent, par exemple, la difficulté de concilier nos intuitions de l’espace et du temps avec les connaissances scientifiques, comme le chat de Schrödinger ou le paradoxe des jumeaux, ou la difficulté à fonder certains de nos savoirs comme le paradoxe de Russell ou le paradoxe de Gettier. Les paradoxes fonctionnent également comme des dispositifs rhétoriques, attirant l’attention ou suscitant la recherche d’explications. Ainsi, John Locke remarquait que « le roi d’un vaste et fertile territoire [en Amérique] est moins bien nourri, logé et vêtu qu’un simple journalier en Angleterre ». En combinant observations directes et faits rapportés, les économistes des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ont imaginé un monde d’énigmes. Du paradoxe de M. de Malestroit aux Vices privés, bénéfices publics de Bernard Mandeville, du paradoxe de l’épargne théorisé par John Neville Keynes puis Paul Samuelson aux paradoxes d’histoire économique de Paul Bairoch, du paradoxe de Condorcet aux paradoxes en théorie du vote, la tension entre comportements individuels et résultats agrégés est une interrogation structurante de longue date. Si les paradoxes ont partie liées aux contractions, il semble qu’il faille cependant les distinguer. Ainsi, pour Hegel, l’histoire produit des contradictions qui sont dépassées dans un processus dialectique engendrant une nouvelle forme et intégrant la contradiction en elle-même. Marx renverse cette logique, situant les contradictions dans le monde matériel, au sein du système capitaliste. L’un des axes du colloque sera précisément de mieux comprendre les points communs et les divergences entre paradoxes et contradictions. Car, en économie, la plupart des paradoxes révèlent des tensions dans le monde de la théorie. Du simple paradoxe de Giffen au paradoxe d’Edgeworth, jusqu’aux paradoxes complexes de la théorie du capital, ils mettent au jour des hypothèses implicites et remettent en cause les théories établies. Certains paradoxes touchent au cœur de la théorie de la valeur, comme le paradoxe de l’eau et du diamant, les paradoxes de Malestroit, le paradoxe de Lauderdale ou celui du care. Avec l’essor de l’individualisme méthodologique dans la seconde moitié du XXe siècle, les économistes se sont fortement intéressés aux écarts entre comportements et rationalité (paradoxes de Saint-Pétersbourg, d’Allais, d’Ellsberg ou encore paradoxe des chaînes de magasins). L’intérêt pour ces énigmes théoriques a été renforcé par les expériences en laboratoire pour faire surgir de nouvelles approches. Plus largement, les réflexions normatives sur la nature humaine se sont également confrontées à des paradoxes : de l’« insociable sociabilité » chez Kant au paradoxe de l’hédonisme chez John Stuart Mill. Économistes et philosophes s’intéressent alors aux tensions politiques, comme le conflit de valeurs identifié par Amartya Sen dans son paradoxe libéral, la tension entre tradition et changement institutionnel chez James Buchanan, ou encore les limites de l’utilitarisme signalées par Derek Parfit avec son paradoxe de la simple addition. Ajoutons que, le problème de l’agrégation des choix individuels, pris en charge par la théorie du choix social, est riche de contradictions formelles : paradoxe de Condorcet, théorème d’impossibilité d’Arrow, paradoxe du vote de Downs, théorème de Gibbard–Satterthwaite, paradoxe doctrinal, etc. Le développement contemporain du choix social donne cependant parfois l’impression d’une recherche de paradoxes pour elle-même sans considération des contreparties empiriques. Tous les paradoxes ne résident pas dans la tête des théoriciens. La collecte minutieuse de données et l’analyse statistique ont révélé des énigmes surprenantes qui défient notre compréhension du changement économique, comme le paradoxe de Jevons, le paradoxe de Leontief, la malédiction des ressources naturelles, le paradoxe de la productivité ou encore le paradoxe d’Easterlin. Enfin, certaines recommandations politiques liées aux contraintes économiques de l’action publique se cristallisent dans des paradoxes puissants, comme l’Antitrust Paradox de Robert Bork, la loi de Baumol, le dilemme de Triffin, le triangle de Mundell, ou le trilemme de Dani Rodrik. Nous sollicitons des contributions qui explorent les paradoxes et contradictions sous tous les angles : formel, conceptuel, historique, normatif etc. Les approches interdisciplinaires sont particulièrement encouragées, ainsi que les perspectives critiques qui interrogent leur rôle dans la construction du savoir économique et leur lien avec les approches philosophiques. Les contributions pourront aborder, par exemple, les thèmes suivants :
Nous invitons aussi des communications sur tout sujet à l’intersection de la philosophie et de l’économie. L’objectif du colloque est de fournir un espace d’échange intellectuel riche et inclusif.
Modalités de soumission Nous invitons les propositions de communication en français ou en anglais, entre 200 et 600 mots, présentant clairement la thèse, l’argument et la pertinence de la contribution pour le thème du colloque ou pour les discussions interdisciplinaires entre philosophie et économie. Les doctorants et jeunes chercheurs sont particulièrement encouragés à participer. Les propositions doivent être soumises avant le 31 décembre 2025 sur le site web du colloque. Les décisions seront communiquées avant le 22 février 2026. Afin de favoriser les discussions, les articles complets devront être chargés sur le site web avant le 1er mai 2026. Nous invitons également des propositions de sessions complètes sur tout sujet reliant économie et philosophie. Celles-ci doivent comprendre un titre, une description (environ 300 mots), et la liste des communications proposées avec noms, affiliations et titres des contributions. Les propositions de sessions doivent être envoyées par courriel à philoeco2026@sciencesconf.org. Chaque communication devra également être soumise via le site web du colloque et sera évaluée par le comité scientifique.
Langues Nancy Cartwright et Elizabeth Maggie Penn délivreront les conférences plénières en anglais. Au moins une session parallèle par bloc devrait se dérouler en français.
Lieu Le colloque, organisé par le Bureau d’Économie Théorique et Appliquée (BETA) en collaboration avec les Archives Henri-Poincaré, se tiendra à la Faculté de droit, économie et gestion de l’Université de Lorraine (13 Place Carnot, 54000 Nancy). Un cocktail de bienvenue sera organisé le mercredi 20 mai au soir, la veille du colloque. Le dîner de gala aura lieu le 21 mai à l’Hôtel de Ville, sur la splendide Place Stanislas. |
CONTACT DATES Ouverture des soumissions : 17 Octobre 2025 Date-limite des soumissions : 31 Décembre 2025 Prolongation des soumissions jusqu'au 16 janvier 2026 Notification aux auteurs : 22 Février 2026
Cocktail d'accueil : 20 Mai 2026, soirée Ouverture de la conférence : 21 Mai 2026, matin Fin de la conférence : 22 Mai 2026, soirée
DROITS D'INSCRIPTION Ouverture des inscriptions : 25 février 2026 Tarifs à venir Fermeture des inscriptions : 1er mai 2026
Traitement des données personnelles |



